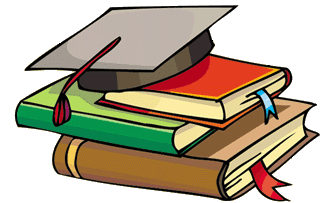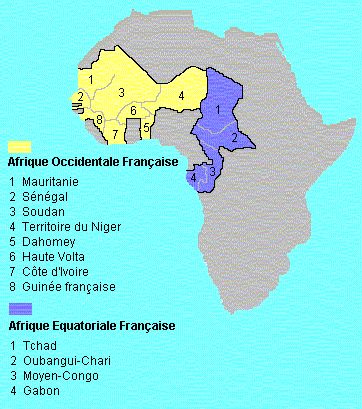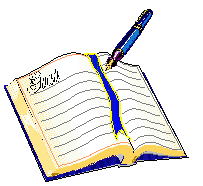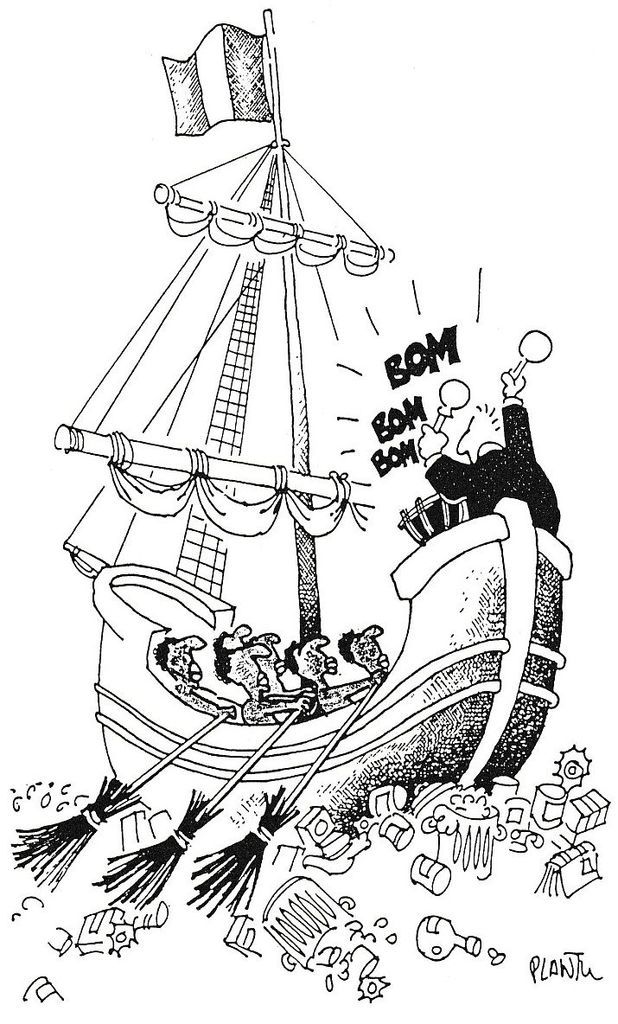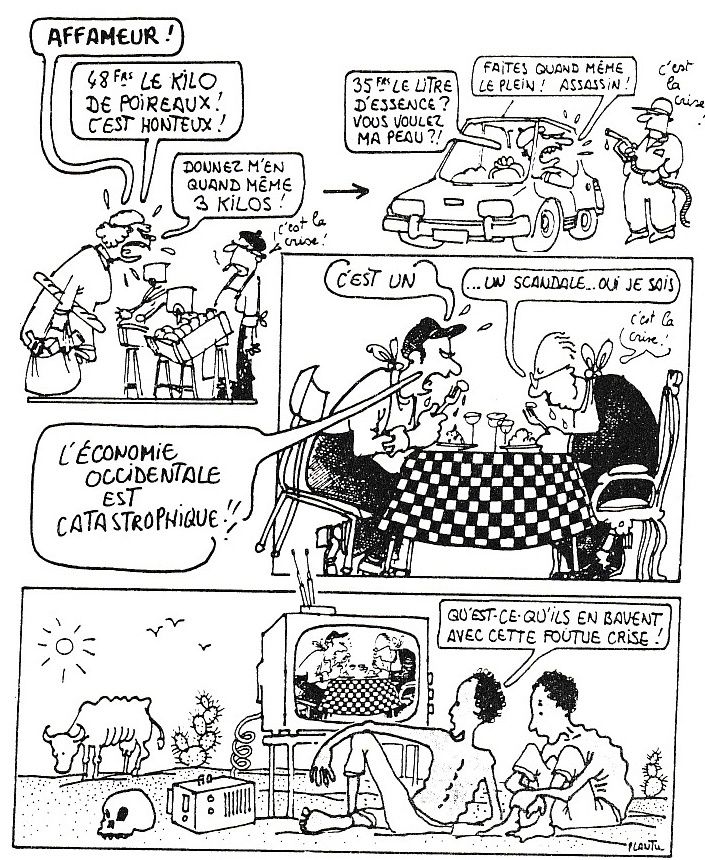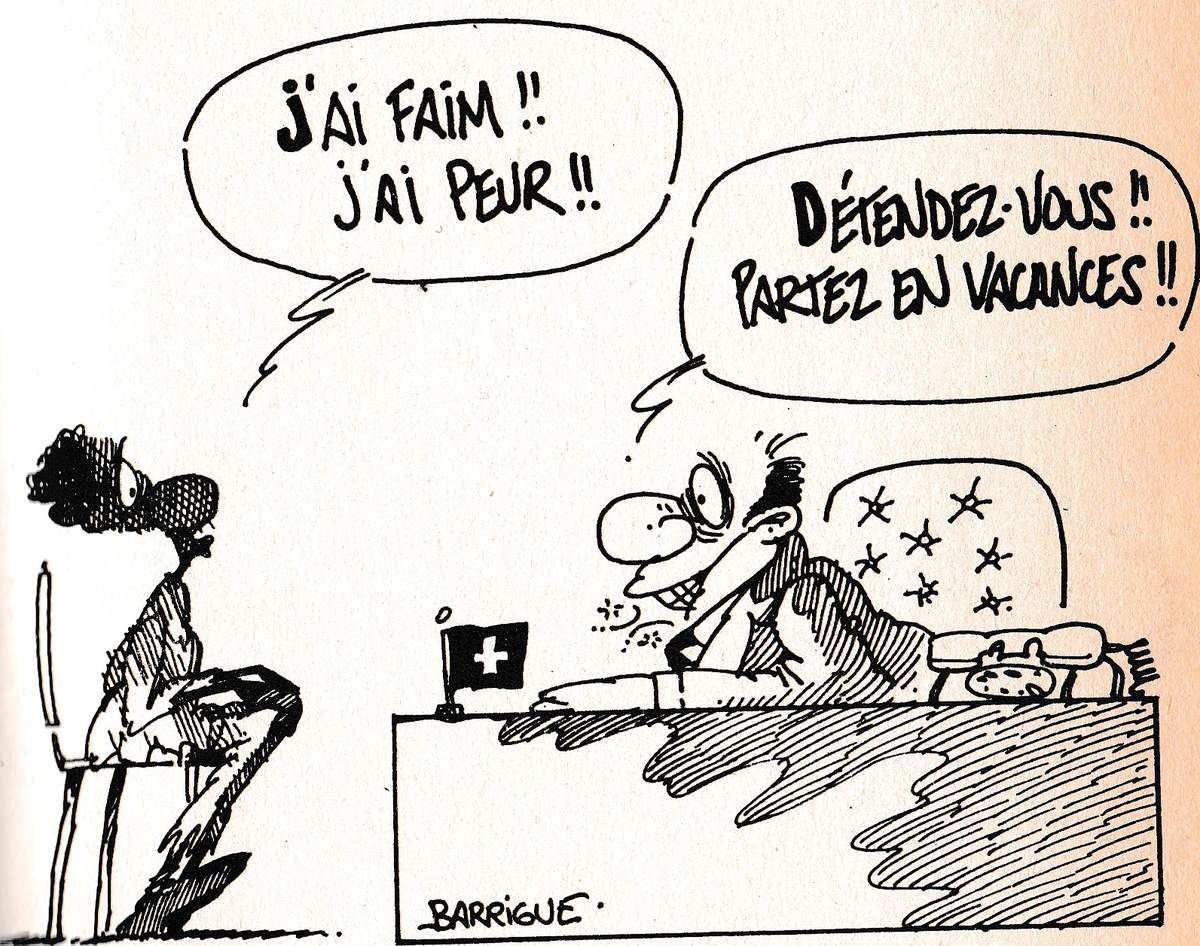L’ÉCOLE CANTONALE. RÉMINISCENCES. 1950-1960

Souvenirs et nostalgie

L’école cantonale


Chant au goût de bonbons au miel
Ils vont à l’école,
Tous les écoliers,
En troupes frivoles
Parmi les sentiers.
Les petites filles
Ont de beaux boubous,
Dans leurs cheveux brillent
De jolis bijoux.
Hauts comme trois pommes
De petits garçons,
Fiers comme des hommes
Chantent des chansons…


CM1-CM2. Textes d’ouverture au monde et à nous-mêmes
LE DEVOIR À L’ÉCOLE
Travaille de ton mieux à l'école où tu es placé ; applique-toi de tous tes efforts à profiter de ce qui t'est enseigné. Songe bien qu'on pourrait déjà tirer un certain travail de tes petits bras et de tes petites jambes. On ne le fait pas cependant. Une comparaison va t'expliquer pourquoi.
Quand le maïs a poussé en herbe et que le champ ressemble à une prairie, on pourrait le couper et le faire manger au bétail, qui ne demanderait pas mieux. Mais cette herbe-là n'est pas une herbe comme les autres. Qu'on laisse avancer la saison, et de chaque tige il va sortir un épi de grains de maïs, dont les hommes se nourrissent, et que Je propriétaire, s'il ne le consomme, vendra argent comptant.
Eh bien ! tu es, toi aussi, un pied de maïs. Si l'on t'employait, dès à présent, à travailler autant que tu le peux sans te rien apprendre, tu ne serais jamais qu'un manœuvre, ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter ; tu ne vaudrais jamais que ce que valent tes bras, tes jambes, tes épaules, tes reins. Mais si l'on permet à ton intelligence de se développer par l'instruction, à la valeur de ton corps tu ajouteras celle de ton esprit ; tu pourras devenir non seulement un ouvrier, mais un contremaître ou un patron, l'égal d'un homme bien plus riche et plus favorisé que toi ; tu pourras te faire la place dont tu seras digne par ton courage et ton intelligence.
Veux-tu bien comprendre ta situation ? Ta famille et ton pays s'appliquent à te mettre entre les mains un outil admirable, dont c'est toi qui dois surtout profiter. Ils s'imposent pour cela des sacrifices. Que demande-t-on en échange ? De la bonne volonté, rien de plus. Si tu n'apportais pas cette bonne volonté, tu serais un ingrat.
Ch. Bigot.


L’utilité du savoir
(Légende balali-Moyen-Congo)
Dieu créa l'Afrique et le reste du monde, puis les hommes noirs et les hommes blancs. En Afrique, il plaça tout ce qui peut faire plaisir aux créatures humaines : des biches sans nombre pour les chasseurs, des rivières poissonneuses pour les pêcheurs, les fruits qui croissent sans peins, une température toujours chaude. Dans le reste du monde, il mit le froid, la glace, la neige, la terre ingrate, mais aussi les livres et le savoir qu'ils renferment.
Il demanda tout d'abord aux hommes noirs de choisir le pays qu'ils voulaient. Bien entendu les Noirs choisirent l'Afrique, et les Blancs durent se contenter du reste du monde. Or l'avenir démontra que les Noirs avaient commis une grosse sottise. Certes les Blancs eurent très froid et ils furent obligés de travailler sans cesse pour tirer la nourriture de leur maigre sol ; mais le savoir des livres leur donna une merveilleuse puissance grâce à laquelle ils construisirent des maisons confortables, confectionnèrent des vêtements moelleux et chauds, obligèrent la terre à leur donner des récoltes abondantes et des fruits savoureux.
Et c'est pourquoi les Noirs, qui ont compris leur erreur, désirent tellement s'instruire à leur tour.
A. Davesne


Ce que c’est qu’un livre
Voici ce qui se serait passé entre deux hommes, dont l’un savait lire et l’autre ne savait pas : « Que regardes-tu dans ce papier ? demandait l’ignorant. — Oh ! si tu savais, répondit le lecteur, comme cela est amusant ! Il y a là des personnes qui parlent ; on entend avec les yeux. » La définition n’était pas mauvaise ; beaucoup de personnes pourraient s’en faire honneur.
Cet homme, en effet, a compris ce que c’est qu’un livre. Si je demandais la définition d’un livre, j’embarrasserais bien des gens. On sait que c’est un assemblage de feuilles de papier sur lesquelles on a imprimé des caractères ; mais ce qui constitue véritablement le livre, on ne le sait pas, faute de réflexion.
Un livre est une voix qu'on entend, une voix qui vous parle : c'est la pensée vivante d'une personne séparée de nous par l'espace ou le temps ; c'est une âme. Les livres réunis dans une bibliothèque, si nous les voyions avec les yeux de l'esprit, représenteraient pour nous les grandes intelligence de tous les pays et de tous les siècles qui sont là pour nous parler, nous instruire et nous consoler. C'est là, remarquez-le bien, la seule chose qui dure : les hommes passent, les monuments tombent en ruines ; ce qui reste, ce qui survit, c'est la pensée humaine.
(Discours populaire)


Enfant que vas-tu faire à l’école ?

À l’école, que vas-tu faire, petit enfant ?
Je vais apprendre à lire pour savoir ce qu’il y a dans les livres. Écoutez bien. Tout en tournant ces pages tachées de noir, n’entendez-vous pas un bruissement confus de voix venues de je ne sais où, du fond des abîmes des siècles passés ? Ce sont les morts qui parlent sans que désormais aucune force puisse faire taire leur parole…

À l’école, que vas-tu faire, petit enfant ?
Je veux savoir comment, au travers des cieux, se propage d’un monde à l’autre la lumière ; comment au choc des nuages s’allume la flamme rapide de l’éclair. Je veux voir monter la sève depuis les robustes racines du chêne jusqu’aux fines dentelures de feuillage qui couronnent sa tête. Je veux voir circuler par mille canaux jusque dans les replis du cerveau le fleuve rouge du sang…

À l’école, que vas-tu faire, petit enfant ?
Alors que je n’étais pas encore, que n’étaient pas non plus et mon père et ma mère que je connais, d’autres étaient que je ne connais point. Chers êtres mystérieux qui avez fait la Patrie, je ne veux pas seulement savoir vos noms, je veux savoir aussi vos actes. Je veux apprendre l’histoire.

À l’école, que vas-tu faire, petit enfant ?
... Je suis venu en ce monde pour être utile, pour être juste, pour être bon... Je ne suis encore, il est vrai qu'un petit enfant, mais je veux être un homme. On n'est pas seulement un homme par la taille. On est aussi un homme par la raison et par le cœur.
École de mon pays, je t'apporte mon âme. De cette jeune âme plus débile encore que le corps qui l'enveloppe, fais une âme française, fais une âme humaine...
Léon Deries (Salut à l’école)


Ajoutons à l’humanité
On ne vous demande pas des miracles, on désire seulement que vous laissiez quelque chose après vous. « Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. » C'est un proverbe indien qui le dit. En effet, il a ajouté quelque chose à l'humanité. L'arbre donnera des fruits, ou tout au moins de l'ombre, à ceux qui naîtront demain.
Un arbre, un toit, un outil, une arme, un vêtement, un remède, une vérité démontrée, une découverte scientifique, un livre, une statue, un tableau : voilà ce que chacun de nous peut ajouter au trésor commun.
Il n'y a pas aujourd'hui un homme intelligent qui ne se sente lié par des fils invisibles à tous les hommes passés, présents et futurs. Nous sommes les héritiers de tous ceux qui sont morts, les associés de tous ceux qui vivent, la providence de tous ceux qui naîtront.
Pour témoigner notre reconnaissance aux mille générations qui nous ont fait graduellement ce que nous sommes, il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. Pour remercier dignement les travailleurs innombrables qui ont rendu notre habitation si belle et si commode, il faut la livrer plus belle et plus commode encore aux générations futures.
Nous sommes meilleurs et plus heureux que nos devanciers, faisons que notre postérité soit meilleure et plus heureuse que nous. Il n'est pas d'homme si pauvre et si mal doué qui ne puisse contribuer au progrès dans une certaine mesure.
Celui qui a planté l'arbre a bien mérité, celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité ; celui qui assemble les planches pour faire un banc a bien mérité ; celui qui s'assied sur le banc, prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire, a mieux mérité que tous les autres. Les trois premiers ont ajouté quelque chose aux ressources de l'humanité ; le dernier a ajouté quelque chose à l'humanité elle-même. De cet enfant il a fait un homme éclairé, c'est-à-dire meilleur.
E. About (Le Progrès)